
Rencontre
avec Luc Baba auteur, acteur et ... passeur
Publié le 4 juin 2009, par
La passion d’écrire
Luc Baba est né à Liège en 1970. Il y vit dans le quartier du Laveu et y enseigne l’anglais dans une École de promotion sociale. Homme aux multiples talents, il a été acteur et auteur pour le théâtre. Compositeur, il a chanté Ferré, Brel et Brassens. Couronné dès son premier roman en 2001, il est désormais un romancier affirmé y compris auprès des jeunes pour qui il écrit et qu’il rencontre régulièrement.
Très amicalement, il a accepté d’évoquer pour nous, à bâtons rompus, son œuvre déjà abondante, sa passion d’écrire, quelques-uns de ses centres d’intérêt et de ses projets.
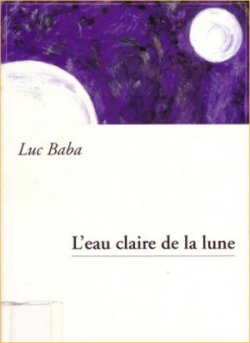
G.D. Luc, tu as publié neuf romans chez Luce Wilquin depuis La cage aux cris qui a reçu le prix « Pages d’or ». En huit ans, c’est une production conséquente déjà...
L.B. Il est vrai que j’écris beaucoup. Plus d’un roman par an, puisque j’ai aussi donné deux romans pour adolescents chez d’autres éditeurs... La confiance et le soutien de mon éditrice m’ont offert le confort d’un tel rythme de publication. Aujourd’hui, je me dis que j’aurais pu mûrir tel ou tel de ces romans (If, par exemple) ou encore être plus sévère avec moi-même peut-être. Mais à l’évidence, cette complicité a été une grande chance.
G.D. Peut-on dire que tu t’attaches à décrire des « petites gens » du quotidien ?
L.B. Chacun de mes personnages est saisi dans un moment de crise. J’essaie de montrer comment des gens ordinaires mais meurtris ou marginaux affrontent leur destin, la dureté du monde. Comment, dans des circonstances difficiles, ils (elles) luttent contre ce qui leur arrive ou qui les accable. Face à la mort ou l’amour, la révélation des origines ou une grossesse... (Loula de L’eau claire de la lune, Pierre Grijs Le marchand de parapluies, Barbot le conteur alias Monsieur l’ours...). Je pars à la recherche de ces personnages, je me laisse conduire par eux, je les « écoute » en portant sur eux un regard nuancé, je tente de chercher ce qu’il y a de l’autre côté du mur. Souvent, leur histoire reste ouverte. Je laisse le lecteur en suspens.
Ils sont souvent hors-norme, c’est vrai, sauf, par exemple Paul Lambion, le professeur de La petite école Sainte-Rouge. C’est un homme banal qui se perd dans son vide intérieur et à qui on demande de donner des cours de philosophie. Mais il n’a rien en lui qui l’en rende capable. C’est cela son tourment.
G.D. Dans Les écrivains n’existent pas, il y a notamment cette phrase : « Heureusement que j’écris, sinon quoi ? J’existerais ».
L.B. Oui... C’est un de mes livres préférés mais il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce roman... Que j’assume. Je veux dire que je ne voudrais pas « exister » comme la plupart des gens : chaque jour des horaires serrés, des transports bondés, courir sans arrêt... L’écriture me garde de cela, me permet de rester à l’écoute de ce que je vis...
G.D. Alors, l’écriture pour toi, c’est une nécessité ?
L.B. Il est difficile de parler de ce qui nous touche profondément. Alors, pourquoi j’écris...?
Je peux dire que l’écriture est identitaire. Depuis l’âge de sept ans j’écris « mes » textes. Même à l’école, il m’arrivait d’écrire deux, voire trois versions de la rédaction demandée. J’écrivais pour le plaisir... J’ai longtemps pensé que j’écrivais pour compenser le silence où me confinait l’austérité du climat familial. Mais aujourd’hui, je ne le pense plus. En fait, depuis toujours, j’ai une passion pour les mots, spécialement de la langue française. Et dans mes cours d’anglais, c’est encore le mot qui m’intéresse, son origine, sa composition, sa sonorité...
G.D. Tu écris sans arrêt...?
L.B. Oui, l’écriture étant une forme de méditation, j’écris chaque jour et dans les endroits les plus improbables. Mon bonheur par exemple, c’ est d’écrire une heure dans le train, sur un banc, dans le brouhaha d’un café... Je me souviens même qu’à l’armée, je prenais des notes sur un petit carnet en plein milieu des exercices de tir à la grenade ! De plus, je travaille toujours plusieurs romans en même temps. Si je passe plusieurs jours sans écrire, je ne suis pas bien. C’est comme si je me trahissais, comme si je n’avais pas de raison d’être.
En fait, la création c’est comme une carriole que l’on met en route. Au démarrage, il y faut beaucoup d’énergie, puis ça roule. Alors, il suffit de lâcher prise et de laisser venir, en orientant un peu mais sans trop contrôler. Le chemin du texte existe. Il n’y a qu’à prendre le temps de le rejoindre.
G.D. Tu tiens également à garder le contact avec de jeunes lecteurs...
L.B. En effet, il m’arrive fréquemment d’aller à leur rencontre un peu partout en Wallonie, à Bruxelles, dans les écoles ou à l’occasion d’initiatives particulières comme l’adaptation de Clandestins par de futurs éducateurs à Liège. Je leur lis des extraits de mes textes. Parfois longuement. Ce sont de grands moments. Car ils écoutent le plus souvent avec attention et me posent beaucoup de questions pertinentes. « D’où viennent les idées ? », « Pourquoi écrit-on ? ». Certains sont perturbés par mon écriture et s’inquiètent : « Est-ce qu’il faut souffrir pour écrire ? ». Inutile de dire que je démens : la souffrance n’est pas une source d’inspiration obligée. Il n’est pas nécessaire de broyer du noir pour écrire...
G.D. Ils te demandent parfois des conseils ?
L.B. Un écrivain, ça les intrigue, notamment à partir de leur expérience d’écriture souvent peu attrayante dans le cadre scolaire : comment écrire avec plaisir, mal assis, agressé par le coude de son voisin ?
Comme aux participants de mes ateliers d’écriture, je leur dis l’importance des conditions, des rites qui entourent l’acte d’écrire : moments, lumière, musique, silence... selon la sensibilité de chacun. Pourquoi, par exemple, ne pas leur permettre une musique discrète si cela les met en condition pour rédiger un texte en classe... Je leur raconte ma colère et ma frustration quand un enseignant reprenait ma feuille alors que j’étais insatisfait d’un mot ou que mon texte n’était pas achevé. Mais je rappelle aussi l’encouragement précieux d’une professeur de français qui, à l’occasion d’un travail d’imitation de Balzac, m’avait gratifié d’un : « Balzac, en mieux ! »
G.D. Donc, tu écris volontiers pour eux...
L.B. Oui, ça me plaît beaucoup. Par exemple, Comme sur des roulettes ou Clandestins(Labor, 2005) un roman qui marche bien. Cette histoire de Vahide, émigrée du Kosovo, touche les jeunes. Une thésiste de Trieste en a déjà traduit huit chapitres en italien. Les lecteurs de ce pays, qui rencontrent ces problèmes d’immigration, sont particulièrement intéressés par ce texte qui parle du sol, des racines et de l’exil.
Actuellement, je travaille à un autre roman pour adolescents : Le club des mouches. Ce sera l’histoire d’une jeune fille qui se trouve laide et qui sombre, par dépit et vengeance, dans des expériences-limites. Mais elle croise un couple d’apiculteurs. Ils ont eux-mêmes perdu une fille qui lui ressemblait et l’accueillent avec une gentillesse excessive...
G.D. L’enseignement, une envie de transmettre ?
L.B. Ce mi-temps en promotion sociale me convient dans la mesure où il me laisse du temps pour écrire et surtout me permet de rester en éveil par rapport au vécu des gens. Même si je ne suis pas un auteur qui écrit dans sa tour d’ivoire, à l’écart du monde. Je me sens très concerné par les problèmes de société, d’information et de culture. Ainsi en décembre dernier, je me suis beaucoup investi pour faire connaître la situation d’un écrivain de Djibouti, Houssein Barkat Toukale, qui avait dénoncé, dans son roman L’enfant de corne le sort fait à son ethnie en Ethiopie. Réfugié en Belgique, il s’est retrouvé à Vottem. J’ai alerté la presse et parlé dans plusieurs radios en faveur de sa libération. Pour faire savoir aussi qu’à Vottem, il y a des gens qui portent et apportent le meilleur. Il a été libéré le 23 décembre 08.
Par ailleurs, mes étudiants, adultes, ne sont pas là pour s’intéresser à ce que j’écris. Les cours sont surtout pour moi l’occasion d’un contact avec leur réalité, de parler de leur histoire. De mettre en scène, parfois, la lourdeur de leur passé. Ce qui m’intéresse c’est le contact pédagogique, la rencontre. Dans certains de mes romans, je me suis d’ailleurs inspiré de certaines élèves (comme Loula dans L’eau claire de la lune ou Vahide de Clandestins).
G.D. Quelle place occupe la lecture dans ta vie ? Es-tu un grand lecteur ?
L.B. Je lis assez peu de romans. Surtout de la poésie. Et quelques textes qui m’accompagnent, que j’ouvre au hasard, dont je relis l’un ou l’autre passage (Les romans d’Aragon, Le Journal de Jules Renard, Giono..). Et comme je souhaite garder les livres que j’aime, souvent achetés d’occasion, je fréquente peu les bibliothèques sinon lorsque j’ai besoin d’une documentation précise.
J’ai aussi tenu une chronique pendant un an dans « Le Vif ». J’avais en principe carte blanche. Ce qui m’intéressait, c’était de me plonger dans le travail de l’écrivain, de rejoindre le cœur du roman... J’appréciais assez les propositions d’Actes Sud, une maison d’édition qui traduit de bons textes en littératures étrangères. Les amis de la jeune librairie « Livre aux trésors » m’aidaient dans mes choix. Mais ceux-ci n’étaient pas jugés assez « populaires ». La collaboration avec l’hebdomadaire a cessé depuis.
G.D. Le théâtre, la chanson, ça continue ?
L.B. J’ai eu beaucoup de plaisir à chanter Brel, Ferré, Brassens. Je conserve un merveilleux souvenir du spectacle Brel, ça va que nous avons donné avec succès avec Christine Bruno au festival de Stavelot en 2004 puis repris à l’Etuve... J’ai connu de grandes joies au théâtre également, comme acteur et auteur... Mais à présent, les contraintes horaires en soirée me pèsent. Alors, aujourd’hui je me consacre essentiellement au roman et à quelques nouvelles : « Couleurs livre » vient de m’en demander une sur le thème de la pauvreté. Mais sans négliger les ateliers d’écriture. J’investis désormais moins dans le slam mais avec Dominique Massaut et Vincent Tholomé nous avons créé un petit groupe de performances poétiques « Les pinces de Mélanie » qui se produira notamment fin juin au festival de la poésie à Périgueux.
G.D. Alors à présent...?
L.B. A considérer ce que j’ai publié (une dizaine de manuscrits sont et resteront dans mes tiroirs) je me rends compte aujourd’hui , car c’était inconscient, que j’ai écrit trois textes inspirés de mon vécu, qui sont comme des balises sur mon parcours : La cage aux cris (2001), sorte de roman d’apprentissage où je raconte mon enfance et mon adolescence ; Les écrivains n’existent pas (2005) dans lequel le personnage principal est un jeune écrivain en proie à des tourments amoureux, à l’écriture et à la mort et Tout le monde me manque (2008) : John, un grand môme de solitude et de manque, refuse d’avoir un rôle dans ce monde. Mais au lieu de l’aider à quitter cette route sombre, chacun(e) autour de lui s’obstine à lui en assigner un, jusqu’à l’emmurer dans l’espace réduit où il échoue.
G.D. C’est un texte important pour toi ?
L.B. J’y suis allé au plus loin de l’exploration de mes ombres. C’est d’ailleurs un texte dont la violence a dérangé plusieurs de mes lecteurs... et certains critiques. D’autres m’ont trouvé au meilleur de mon écriture. J’avais « monté d’un cran dans l’exercice narratif » (Thierry Detienne). Mais il règne à présent un étrange silence autour de ce livre.
Il reste qu’avec ce roman et l’adaptation pour le théâtre que j’en ai faite sous la forme d’un monologue que j’ai interprété à la Courte Echelle, il me semble qu’une période se clôt dans ma vie comme dans mes textes. Comme s’il m’avait fallu tout ce temps pour jeter hors de moi, par étapes et à force d’introspection, toute la part de douleur qui m’habitait. Je suis à un tournant. Ces moments-là ne se décident pas. Je me sens à présent plus serein, j’aspire à plus de calme. Loin de la pollution et du parasitage intérieurs.
G.D. Cela va-t-il changer le ton de tes prochains romans ?
L.B. Certainement. Je veux prendre tout le temps nécessaire pour aller au bout de mes textes, sans hâte de publier. J’écris avec plus de liberté, de légèreté. Avec davantage de plaisir et même d’humour. Ainsi, mon prochain roman partira encore d’une situation de crise mais en allant vers plus d’apaisement : un homme apprend qu’il va perdre l’usage de ses sens. Son médecin lui conseille de s’y préparer. Mais comment ? S’abstenir pour ne pas souffrir du manque ou goûter avec une dernière avidité à toutes les saveurs, à tous les délices ? Il ne lui restera que le toucher à découvrir et il prendra finalement conscience à la fois du trésor que représente la faculté de goûter au monde, de l’incorporation bâclée de ce qui nous entoure, du peu de soin accordé à l’intériorité...
G.D. Une sorte de réconciliation avec lui-même ?
L.B. Oui. Comme dans le nirvana : souffler sur la flamme visible parce que l’on a trouvé une lumière en soi. Je crois que Léo Ferré avait tort en disant que le bonheur c’est pour les imbéciles. Je n’allais pas bien quand j’ai cité en exergue de Les écrivains n’existent pas une de ses autres phrases : « Le bonheur, c’est du chagrin qui se repose ». J’avais omis la suite : « Il ne faut pas le réveiller »...
Orientation Bibliographique
- Luc BABA, La cage aux cris, Editions Luce Wilquin, 2001
- Luc BABA, De la terre et du vent, Editions Luce Wilquin, 2002
- Luc BABA, L’eau claire de la lune, Editions Luce Wilquin, 2003
- Luc BABA, Le marchand de parapluie, Editions Luce Wilquin, 2004
- Luc BABA, Les écrivains n’existent pas, Editions Luce Wilquin, 2005
- Luc BABA, If, Editions Luce Wilquin, 2005
- Luc BABA, Monsieur l’Ours, Editions Luce Wilquin, 2006
- Luc BABA, La petite école Sainte-Rouge, Editions Luce Wilquin, 2007
- Luc BABA, Tout le monde me manque, Editions Luce Wilquin, 2008
Jeunesse
- Luc BABA, Clandestins, Labor J, Jeunesse, 2006
- Luc BABA, Comme sur des roulettes, Averbode, 2007









