
Regards croisés sur des
Paroles de femmes
Publié le 13 décembre 2005, par
Conversations sur la vie et le bonheur ; écritures sensibles, singulières, intimistes ; regards tendres, lumineux mais toujours clairvoyants voire implacables...
Qui, mieux qu’une femme, peut , avec nuances, sensibilité, authenticité et force, nous inviter à enfanter un juste regard sur la vie et la passion ?
En ces temps de naissance, Gérard Durieux nous convie à ces dialogues de libertés et de vérités.
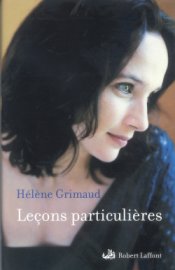
GRIMAUD Hélène, Leçons particulières, Robert Laffont, 2005.
On la connaît surtout comme pianiste. Interprète charismatique de Brahms ou de Rachmaninov, cette femme à l’hypersensibilité ravageuse, est aussi celle qui « danse avec les loups ».
Cette lumineuse trentenaire de souche française, a en effet ouvert aux Etats-Unis « le Wolf Conservation Center » qu’elle anime avec une passion toute pareille à celle qui habite sa carrière musicale... et désormais littéraire.
Car après avoir écrit une sorte d’autobiographie en 2003
« Variations sauvages » (Laffont), elle récidive avec ce nouveau récit « initiatique ». Surmenée, épuisée, elle décide de s’offrir un long voyage de ressourcement sur les lieux qu’elle aime. L’Italie surtout. Pour se retrouver, pour « retourner au monde qui roule et qui mugit ». Ce sera l’occasion de rencontres, mystérieuses, amicales, éclairantes...
L’intrigue est mince. Mais l’essentiel tient ici en ces conversations sur la vie, la passion, le bonheur... :
« Mon domaine de prédilection est celui des pensées générales », confiait-elle à juste titre à propos de son premier livre. De ces « leçons particulières », on retiendra donc la rare profondeur et la rayonnante maturité de maintes pages.
Les inconditionnels se réjouiront de quelques confidences comme autant d’échappées vers le mystère de cette personnalité fascinante et multiple.
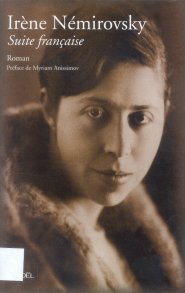
NEMIROVSKY Irène, Suite française, Denoël, 2004.
Suite française ? Car ce livre remarquable, Prix Renaudot 2004, n’est pas isolé. Il couronne en effet une oeuvre d’une vingtaine d’ouvrages (romans, nouvelles, biographie...) dont le premier "David Golder" (1929) (LP2372), roman acerbe sur les mœurs du monde de la finance des années 20, avait été salué unanimement par la critique.
Puis, le silence de l’oubli... jusqu’à l’exhumation récente par sa fille de ce livre écrit durant les mois qui précédèrent sa mort à Auschwitz le 17 août 1942.
Ce roman en deux parties décrit l’Exode de Juin 40 et l’occupation par les allemands d’un petit village français, Bussy. D’une plume brillante, rieuse et cruelle à la fois, cette juive russe issue d’une famille de commerçants émigrée en 1919, traque sans concession les lâchetés, les mesquineries, les compromissions des « bourgeois et de la populace ».
Elle s’attache aussi en contrepoint aux solidarités modestes et à la grandeur silencieuse de certains autres. Tous sont mis à nu, jetés sur les routes ou reclus dans leurs habitudes, leurs peurs, leurs amours et leurs haines.
La présence de l’occupant opère comme un révélateur : elle révèle et exacerbe.
Ce regard implacable et tendre, soutenu par une écriture intimiste, intuitive et précise, nous offre, par touches, une galerie de portraits remarquables et dévoile ligne à ligne les méandres de l’âme humaine.
Un roman magistral, fruit du « génie patient » d’une femme assassinée à l’aube de ses 40 ans par la barbarie imbécile des forts.
Dernier titre paru : Le maître des âmes, Denoël, 2005.

SAUVAGEOT Marcelle, Laissez-moi, Phébus, 2004
Publié en 1933 sous le titre « Commentaire », ce texte court est alors salué par de prestigieux lecteurs (Du Bos, Valéry, Claudel...) comme « un des chefs-d’œuvre de la plume féminine ».
Réédité à plusieurs reprises, il demeura néanmoins injustement oublié. Le voilà, heureusement, à nouveau disponible.
C’est le cri, grave et retenu, d’une jeune femme qui se bat contre la maladie et qui reçoit une lettre « de congé » de la part de son amant : « Je me marie,... notre amitié demeure ».
Ce sont les pages sensibles d’un cœur qui saigne sans se lamenter, une confession d’une fierté clairvoyante et meurtrie. Marcelle « commente » pour elle-même, avec l’infinie lucidité de celle qui a voulu tout donner et qui vient de tout perdre.
Derrière ce récit au scalpel d’une rupture amoureuse, à mille lieues de l’écriture prétendument souffreteuse des
« écrivains de sanatorium », s’éclaire le visage d’une troublante « Antigone de l’amour ».
Assurément la souffrance aiguise la passion et affûte le talent. Et cette voix requiert la connivence d’une écoute lente qui donne aux mots leur pesant de chair et de sang.
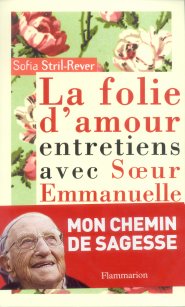
EMMANUELLE (Sr), La folie d’amour, Flammarion, 2005
En août 2004, Jean-Paul II s’adressait aux femmes comme aux « sentinelles de l’invisible ».
Lutteuse acharnée au service de l’enfance saccagée, Sr Emmanuelle qui consacre les derniers jours de sa vieillesse à la contemplation de la « source de tout amour », nous invite à son tour à devenir veilleurs...
Au fil de ce livre d’entretiens, elle répond aux questions qui naissent de l’épreuve, de la souffrance, de la détresse, voire du désespoir. Et sans relâche elle nous renvoie à la « folie d’amour » comme au trésor caché au plus intime de chacun(e).
Le dialogue se prolonge à travers poèmes, méditations ou prières empruntés à des femmes qui furent engagées au nom de leur foi : Catherine de Sienne, Thérèse de Lisieux et d’Avila, Elisabeth de la Trinité, Mère Térésa... Mais aussi Etty Hillesum, Simone Weil, Edith Stein...
C’est un lumineux échange par-delà les siècles et les appartenances confessionnelles entre toutes ces mystiques, ces femmes qui furent elles aussi solidement enracinées dans leur époque. Leurs mots d’amoureuses creusent le désir et engagent à la lutte.
Disons encore que ce témoignage simple de vie et d’expérience spirituelle, propose sur la gaillarde religieuse, un regard différent des clichés médiatiques dont elle paraît parfois s’accommoder avec délices. Joyeux Noël, ma sœur !
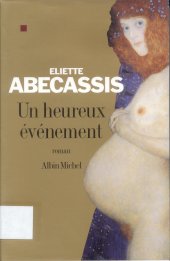
ABECASSIS Eliette, Un heureux événement, Albin Michel, 2005.
Cette jeune romancière née en 69 au Maroc est agrégée de philo. Juive pratiquante, elle est la fille du professeur Armand Abécassis, grand spécialiste de la pensée juive. Presque tout naturellement donc, les premiers ouvrages qui la font remarquer sont des « polars métaphysiques » à succès : Qumran (1996), L’or et la cendre (1997) et Le trésor du temple (2001).
Délaissant le genre thriller religieux, elle avait récemment abordé le roman plus intimiste, plus autobiographique (?) avec Mon père(Albin Michel, 2002).
Ce texte un peu inabouti ouvrait néanmoins une voie, nouvelle et prometteuse, dans sa recherche d’une écriture plus singulière. Ces pages brèves et lancinantes exploraient les désarrois d’une femme déprimée, otage d’un père trop présent, trop puissant, trop idéalisé.
Peut-on dire que l’auteure poursuit ici une recherche de soi et de son identité de femme (fille, épouse et mère) à travers l’évocation corrosive et jubilatoire, férocement drôle des avatars de la maternité ? « Désormais ma vie ne m’appartiens plus. Je n’étais plus qu’un creux, un vide, un néant. Désormais, j’étais mère. » Car sous les phrases légères, le récit désinvolte, réaliste et amer, court un questionnement sur « la vie-l’amour-la mort »,l’inévitable trilogie que sonde toute parole.
Reste un texte intelligent, alerte, cinglant... La maternité, une aventure cauchemardesque ? Ma nièce attend un « heureux événement ». Je passe le bouquin à son mari... d’urgence !
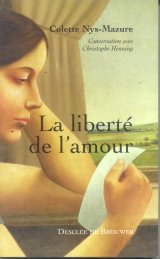
NYS-MAZURE Colette, La liberté de l’amour, Desclée de Brouwer, 2005.
Une œuvre variée, de liberté et d’amour, qui met en mots le quotidien et le célèbre, sans tomber jamais dans la musique guimauve. Ici encore (La liberté de l’amour), au fil des rencontres avec C. Henning, il est question de vie et de mort, de travail, d’éblouissements et de deuils. Colette Nys partage avec simplicité sa vie de femme, de poète et de croyante : voies d’enfance, d’écriture et d’existence.
Sans rien gommer de l’ombre, on avance lentement vers l’aveu d’une lumière venue d’ailleurs : « Le vitrail travaille la lumière, l’écriture l’obscurité intérieure » (Henri BAUCHAU) glisse-t-elle en exergue.
On saisit mieux « que cette douce espérance » fut conquise, un jour, contre les forces de mort en lisant le récit intense du drame de l’enfance :
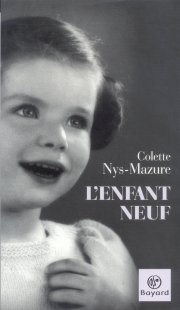
NYS-MAZURE Colette, L’enfant neuf, Bayard, 2005.
Orpheline de père et de mère en quelques semaines, à l’âge de sept ans. (L’enfant neuf) : « Je resterai une petite fille effrayée par l’accident, ce qui surgit brutalement et change la face du jour ». Effrayée et forte pourtant, car les mots de la femme devenue riche de tous ses deuils nomment désormais avec une distance presque légère, la douleur traversée par la petite fille.
Les derniers mots de ce petit livre lumineux sont de désir et d’avenir. « Naître et renaître ... le soleil de l’enfance, fût-il noir, n’en finit pas d’éclairer nos existences, de porter sur elles sa secrète splendeur. Demain il renaîtra, neuf. »
A goûter aussi en ces jours de Noël :
NYS-MAZURE Colette, Célébration de la mère, regards sur Marie, Albin Michel, 2000.
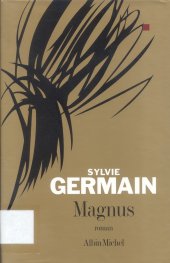
GERMAIN Sylvie, Magnus, Albin Michel, 2005.
« Seuls les lycéens ont-ils vu clair ? » interroge un chroniqueur littéraire. Ils viennent en effet d’attribuer leur « Goncourt » en couronnant ce dixième roman de Sylvie Germain.
Depuis Le livre des nuits (Gallimard, 1984), de texte en texte, elle poursuit par la création d’un univers et de personnages originaux, son interrogation sur le destin de l’homme en ce monde, sur le mal, les ténèbres et les lumières enfouies au cœur de l’humain.
Une fois encore, à travers l’existence de Magnus, elle traque de son écriture précise et nuancée « les ombres venues il ne sait d’où » et qui parcourent sa mémoire en lambeaux.
Elevé par un nazi (il l’ignore longtemps), Magnus va chercher sa vérité et son nom dans les mots menteurs de Théa sa mère d’adoption, sur le visage de Clemens son père imposteur et tortionnaire. L’amour intense de May, l’amitié silencieuse de Lothar et la simplicité du
« Seigneur des abeilles », frère Jean, scandent cette éprouvante remontée vers l’origine. Le texte débouchant comme dans une clairière avec l’apparition en finale du moine clownesque.
De cet homme à la mémoire lacunaire, plombée de mensonges, ... l’auteure avoue ne tracer ici « qu’une esquisse de portrait, un récit en désordre, ponctué de blancs car la chronologie d’une vie humaine n’est jamais aussi linéaire qu’on le croit ».
Mais cette traversée romanesque de soi vers soi est portée à l’incandescence par la découverte du maître livre de la littérature d’Amérique latine Pedro Paramo de Juan Rulfo (Gallimard, L’imaginaire, 1979) : le héros y part à la recherche de son père inconnu... Magnus rejoue cette quête éternelle. Et les mots de la femme-romancière « le font naître une seconde fois ».
Un fort beau texte d’engendrement pour ce temps de naissance.









